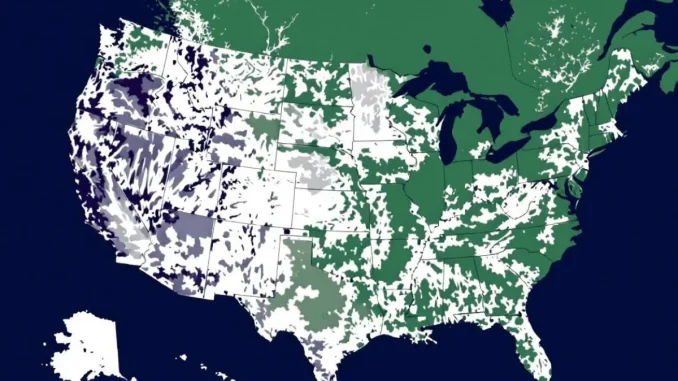
Les bouleversements climatiques engendrent des conséquences dévastatrices pour de nombreux pays, particulièrement ceux en développement qui contribuent le moins aux émissions mondiales. Cette asymétrie fondamentale soulève une question juridique majeure: comment établir un cadre de responsabilité permettant aux États victimes d’obtenir réparation? La notion de « pertes et préjudices » climatiques s’est progressivement imposée dans les négociations internationales, culminant avec la création du fonds spécifique lors de la COP27. Pourtant, les mécanismes juridiques contraignants restent embryonnaires face à l’ampleur des dommages subis. Cette analyse explore les fondements, évolutions et perspectives de la responsabilité étatique pour pertes climatiques, entre solidarité internationale et justice environnementale.
Les Fondements Juridiques de la Responsabilité Climatique des États
La responsabilité des États pour dommages climatiques repose sur plusieurs piliers du droit international. Le principe pollueur-payeur, consacré dans la Déclaration de Rio de 1992, constitue la pierre angulaire théorique de cette responsabilité. Il stipule que les coûts des dommages environnementaux doivent être supportés par ceux qui les causent. En parallèle, le principe des responsabilités communes mais différenciées reconnaît que tous les États doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais selon leurs capacités et leurs responsabilités historiques.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de 1992 a établi un cadre initial sans créer d’obligations contraignantes en matière de réparation. L’Accord de Paris de 2015 marque une avancée en reconnaissant formellement la notion de « pertes et préjudices » dans son article 8, tout en précisant qu’il « ne peut servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ». Cette clause d’exemption, introduite sous la pression des pays développés, illustre les résistances à l’établissement d’un régime strict de responsabilité.
Au-delà des traités climatiques, d’autres sources juridiques peuvent être mobilisées. Le droit international coutumier, notamment le principe selon lequel un État ne doit pas causer de dommages au territoire d’autres États (consacré dans l’affaire de la Fonderie de Trail), offre un fondement potentiel. De même, le droit international des droits humains commence à être invoqué, comme l’illustre l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de 2017 reconnaissant le droit à un environnement sain.
Les obstacles juridiques à l’établissement de la responsabilité
Malgré ces fondements, plusieurs obstacles juridiques majeurs demeurent:
- La difficulté d’établir un lien de causalité direct entre les émissions d’un État spécifique et des dommages climatiques particuliers
- L’absence de juridiction internationale spécifiquement compétente pour les litiges climatiques
- La non-rétroactivité des obligations internationales face à des émissions historiques
- La réticence des États développés à accepter un régime de responsabilité stricte
Ces obstacles expliquent pourquoi la question des pertes et préjudices a longtemps été traitée sous l’angle de la solidarité internationale plutôt que sous celui de la responsabilité juridique contraignante. Cette approche, si elle permet des avancées pragmatiques, laisse en suspens la question fondamentale de la justice climatique pour les États les plus vulnérables.
L’Évolution du Concept de « Pertes et Préjudices » dans les Négociations Climatiques
Le concept de « pertes et préjudices » (loss and damage en anglais) a connu une trajectoire sinueuse dans l’arène des négociations climatiques. Initialement proposé par l’Alliance des Petits États Insulaires (AOSIS) dès 1991, il visait à établir un mécanisme d’assurance international pour compenser les dommages liés à l’élévation du niveau des mers. Cette proposition pionnière est longtemps restée lettre morte face aux réticences des pays industrialisés.
La COP13 de Bali en 2007 marque un tournant avec l’introduction de la notion d’adaptation au changement climatique, préparant le terrain conceptuel pour la reconnaissance des pertes irréversibles. C’est à la COP16 de Cancún en 2010 que le terme « pertes et préjudices » apparaît pour la première fois dans un document officiel des négociations. Trois ans plus tard, la COP19 de Varsovie établit le Mécanisme international de Varsovie (WIM) relatif aux pertes et préjudices, premier cadre institutionnel dédié à cette problématique.
L’Accord de Paris constitue une avancée ambivalente: d’un côté, son article 8 consacre les pertes et préjudices comme un pilier distinct de l’action climatique, au même titre que l’atténuation et l’adaptation; de l’autre, la décision d’adoption précise explicitement que cet article « ne peut servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ». Cette clause d’exemption, exigée par les États-Unis et d’autres pays développés, illustre la tension persistante entre reconnaissance du problème et refus d’une responsabilité juridique contraignante.
La COP26 de Glasgow a vu l’émergence du Dialogue de Glasgow sur les pertes et préjudices, tandis que la COP27 de Charm el-Cheikh en 2022 marque une percée historique avec l’accord sur la création d’un fonds spécifique pour les pertes et préjudices. Cette décision, célébrée comme une victoire par les pays en développement après trente ans de plaidoyer, reste néanmoins à concrétiser dans ses modalités opérationnelles.
- 1991: Première proposition de l’AOSIS sur un mécanisme d’assurance
- 2007 (COP13): Introduction du concept d’adaptation
- 2010 (COP16): Première mention officielle des « pertes et préjudices »
- 2013 (COP19): Création du Mécanisme international de Varsovie
- 2015 (COP21): Reconnaissance dans l’Accord de Paris (article 8)
- 2022 (COP27): Accord sur la création d’un fonds spécifique
Cette évolution témoigne d’un glissement progressif du paradigme: d’une approche initialement centrée sur l’adaptation vers la reconnaissance que certains impacts climatiques dépassent les capacités d’adaptation et nécessitent des mécanismes de compensation. Toutefois, le cadre actuel reste largement volontaire et insuffisamment financé face à l’ampleur des besoins estimés, qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars annuels.
Contentieux Climatiques et Émergence d’une Jurisprudence Internationale
Face aux lenteurs des négociations internationales, le recours aux tribunaux est devenu une stratégie majeure pour faire avancer la question de la responsabilité climatique. Cette judiciarisation se manifeste à deux niveaux: les contentieux nationaux contre les États et les entreprises, et les procédures internationales visant à établir des obligations juridiques contraignantes.
Au niveau national, l’affaire Urgenda aux Pays-Bas constitue un précédent retentissant. En 2019, la Cour suprême néerlandaise a confirmé l’obligation de l’État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% d’ici 2020 par rapport à 1990, en se fondant sur la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision, première du genre à imposer à un État des objectifs climatiques contraignants, a inspiré des contentieux similaires dans de nombreux pays.
En France, « l’Affaire du Siècle » a abouti en 2021 à la condamnation de l’État pour carences dans la lutte contre le changement climatique. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé en 2021 que la loi climatique nationale violait les droits fondamentaux des jeunes générations en reportant l’effort de réduction des émissions sur l’avenir. Ces affaires, fondées sur des principes constitutionnels ou des obligations internationales, contribuent à forger un corpus jurisprudentiel novateur.
Vers une responsabilité climatique transnationale
Les procédures internationales se multiplient également. La Commission des droits de l’homme des Philippines a mené une enquête sur la responsabilité des Carbon Majors (les principales entreprises pétrolières et gazières) dans les violations des droits humains liées au changement climatique. Bien que non contraignante, cette démarche a permis d’établir des précédents conceptuels importants sur la responsabilité des acteurs privés.
Plusieurs initiatives visent directement la responsabilité interétatique. La Commission des droits de l’homme des Peuples des Îles du Pacifique a déposé en 2019 une plainte contre les principaux pays émetteurs. En 2022, les États de Vanuatu et Tuvalu ont lancé une initiative pour obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les obligations des États en matière de changement climatique. Cette démarche, soutenue par l’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2023, pourrait aboutir à une clarification majeure du droit international applicable.
La Cour internationale de Justice n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur la responsabilité climatique des États, mais d’autres juridictions internationales ont commencé à baliser le terrain. Le Tribunal international du droit de la mer a reconnu en 2011 l’obligation des États d’adopter une approche de précaution face aux risques environnementaux, tandis que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a établi en 2017 un lien entre protection de l’environnement et droits humains.
Ces développements jurisprudentiels, encore fragmentés, dessinent progressivement les contours d’un régime de responsabilité climatique qui pourrait à terme combler les lacunes du cadre conventionnel. Ils témoignent d’une évolution du droit international vers une prise en compte accrue des enjeux intergénérationnels et transfrontaliers posés par la crise climatique.
Mécanismes de Compensation et Financement des Pertes et Préjudices
La reconnaissance conceptuelle des pertes et préjudices ne suffit pas; elle doit s’accompagner de mécanismes opérationnels permettant d’acheminer des ressources vers les communautés affectées. Plusieurs approches complémentaires se dessinent pour financer la réparation des dommages climatiques.
Le fonds pour les pertes et préjudices acté à la COP27 représente une avancée symbolique majeure, mais son opérationnalisation soulève de nombreuses questions. La COP28 de Dubaï a permis de clarifier certains aspects de sa gouvernance, avec un conseil d’administration paritaire entre pays développés et en développement. Toutefois, les contributions restent volontaires et largement insuffisantes face aux besoins estimés par la Banque mondiale à plus de 300 milliards de dollars annuels d’ici 2030 pour les seuls pays en développement.
Au-delà de ce fonds spécifique, d’autres mécanismes financiers existent ou sont en développement. Le Fonds vert pour le climat, établi en 2010, a intégré partiellement la dimension des pertes et préjudices dans certains de ses programmes, notamment ceux liés à l’adaptation transformationnelle. L’Initiative de Santiago pour les pertes et préjudices, lancée en 2019, vise à coordonner l’assistance technique aux pays vulnérables pour accéder aux financements existants.
Mécanismes innovants et solutions assurantielles
Face à l’insuffisance des financements publics traditionnels, des mécanismes innovants émergent. L’Alliance mondiale contre les risques climatiques (Global Shield against Climate Risks), lancée par le G7 et le V20 (groupe des pays vulnérables), propose des solutions assurantielles pour couvrir les risques climatiques dans les pays les plus exposés. Cette approche, basée sur le transfert de risques, présente l’avantage de mobiliser des capitaux privés mais soulève des questions d’équité quant à la prise en charge des primes d’assurance.
D’autres propositions plus ambitieuses incluent:
- Une taxe internationale sur les combustibles fossiles dédiée aux pertes et préjudices
- Un mécanisme de compensation financé par les plus grands émetteurs historiques
- Des obligations catastrophe (cat bonds) émises par les institutions financières internationales
- Une taxe sur les transports internationaux (maritime et aérien) affectée aux dommages climatiques
Ces mécanismes se heurtent à des obstacles politiques mais constituent des pistes prometteuses pour générer des financements à la hauteur des enjeux. La Commission mondiale sur l’adaptation estime qu’investir 1,8 trillion de dollars dans l’adaptation climatique d’ici 2030 pourrait générer 7,1 trillions de dollars de bénéfices nets, illustrant la rationalité économique de tels investissements préventifs.
Un défi majeur demeure la définition des critères d’allocation de ces ressources. Comment déterminer quels pays ou communautés sont prioritaires? Quels types de pertes (économiques, non-économiques, culturelles) doivent être compensés? Ces questions complexes nécessitent des cadres d’évaluation robustes qui commencent à émerger, comme la méthodologie développée par le Mécanisme international de Varsovie pour quantifier les pertes non-économiques liées au climat.
L’expérience des fonds d’indemnisation internationaux existants, comme le Fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, offre des leçons précieuses pour la conception de mécanismes efficaces et équitables. Ces précédents montrent qu’une gouvernance inclusive, des règles d’éligibilité claires et des procédures simplifiées sont essentielles pour garantir que les ressources atteignent effectivement les communautés affectées.
Vers un Nouveau Paradigme de Justice Climatique Mondiale
La question de la responsabilité pour pertes climatiques dépasse le cadre juridique traditionnel pour s’inscrire dans une réflexion plus large sur la justice environnementale mondiale. Elle interroge fondamentalement nos conceptions de l’équité intergénérationnelle, de la souveraineté nationale et de la gouvernance des biens communs globaux.
Le concept de dette climatique émerge comme un paradigme alternatif pour penser la responsabilité des États. Développé initialement par des mouvements de la société civile du Sud global, il postule que les pays industrialisés ont contracté une dette envers les pays en développement en utilisant de manière disproportionnée l’espace atmosphérique commun. Cette dette comporte deux dimensions: une dette d’émissions (liée aux émissions historiques excessives) et une dette d’adaptation (liée aux coûts imposés aux pays vulnérables).
Ce cadre conceptuel permet de dépasser l’approche caritative ou volontariste qui prévaut actuellement dans les négociations climatiques. Selon cette perspective, le financement des pertes et préjudices ne relève pas de l’aide au développement mais d’une obligation de réparation fondée sur la responsabilité historique. Des chercheurs du Stockholm Environment Institute ont tenté de quantifier cette dette climatique, estimant que les pays du G7 devraient contribuer à hauteur de 190 milliards de dollars annuels au financement climatique mondial d’ici 2025.
Réformer la gouvernance climatique mondiale
La mise en œuvre effective d’un régime de responsabilité climatique nécessite des réformes profondes de la gouvernance internationale. Le système actuel, fondé sur le consensus et les contributions volontaires, montre ses limites face à l’urgence de la crise. Plusieurs pistes de réforme émergent:
- La création d’une Cour internationale du climat spécifiquement dédiée aux litiges climatiques
- L’intégration des principes de justice climatique dans la réforme des institutions financières internationales
- L’adoption d’un traité de non-prolifération des combustibles fossiles incluant des mécanismes de compensation
- Le renforcement des droits procéduraux des communautés affectées dans les instances décisionnelles internationales
Ces propositions se heurtent à des résistances politiques considérables mais reflètent la nécessité de repenser fondamentalement notre architecture institutionnelle face au défi climatique. La diplomatie climatique est entrée dans une phase critique où les questions de justice distributive ne peuvent plus être éludées.
Au-delà des mécanismes formels, une évolution des mentalités est perceptible. Des initiatives comme le Climate Vulnerable Forum, regroupant 48 pays particulièrement exposés aux impacts climatiques, contribuent à faire évoluer le discours international. De même, l’émergence d’une jurisprudence climatique témoigne d’une prise de conscience croissante des juges nationaux et internationaux quant à l’impératif de protection des générations futures.
L’intégration des savoirs autochtones et des perspectives non-occidentales dans la définition des pertes et préjudices constitue une autre dimension essentielle de ce nouveau paradigme. La reconnaissance des pertes non-économiques, culturelles ou spirituelles liées au climat nécessite de dépasser les approches purement monétaires de la compensation pour embrasser une vision plus holistique de la justice environnementale.
Ce changement de paradigme s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en question du modèle de développement extractiviste qui a conduit à la crise climatique. La responsabilité pour pertes et préjudices ne peut être dissociée d’une transition juste vers des sociétés bas-carbone qui respectent les limites planétaires tout en garantissant les droits fondamentaux de tous.
Le Futur de la Responsabilité Climatique: Défis et Opportunités
L’établissement d’un régime complet de responsabilité pour les pertes climatiques demeure un horizon à construire plutôt qu’une réalité acquise. Plusieurs défis majeurs persistent, mais des opportunités significatives se dessinent également pour faire progresser ce chantier juridique et politique fondamental.
Le premier défi concerne l’attribution scientifique des impacts climatiques. Si la science de l’attribution a considérablement progressé, permettant désormais d’établir la contribution du changement climatique anthropique à certains événements extrêmes, la traduction de ces avancées scientifiques en responsabilités juridiques demeure complexe. Des initiatives comme la World Weather Attribution développent des méthodologies robustes qui pourraient à terme faciliter les recours juridiques, en démontrant par exemple que la probabilité d’une inondation dévastatrice a été multipliée par un facteur spécifique en raison du réchauffement global.
Le défi de la quantification économique des pertes reste particulièrement épineux pour les dommages non-marchands. Comment évaluer monétairement la disparition d’un écosystème, l’extinction d’une espèce, ou la perte d’un patrimoine culturel? Des méthodologies innovantes comme l’évaluation contingente ou les approches multi-critères tentent d’apporter des réponses, mais se heurtent aux limites intrinsèques de la monétarisation des valeurs non-économiques.
Solutions émergentes et innovations juridiques
Face à ces défis, plusieurs pistes prometteuses se dessinent. L’émergence d’un droit international des catastrophes pourrait offrir un cadre conceptuel adapté aux pertes climatiques. Ce domaine juridique en construction s’intéresse aux obligations des États avant, pendant et après les catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine.
Le développement de mécanismes régionaux de responsabilité constitue une autre voie pragmatique. L’Union Européenne a ainsi adopté en 2022 une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui pourrait inclure la responsabilité pour impacts climatiques. De même, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a reconnu dans plusieurs décisions récentes l’obligation des États de protéger leurs populations contre les dégradations environnementales.
Les approches hybrides combinant responsabilité juridique et solidarité internationale semblent particulièrement prometteuses. Le modèle du Fonds pour les victimes de l’amiante au Japon, qui associe contributions obligatoires des entreprises et financement public, pourrait inspirer des mécanismes similaires pour les pertes climatiques. De telles approches permettraient d’assurer une réparation effective des victimes sans s’enliser dans des contentieux interminables.
L’innovation juridique passe également par l’exploration de nouveaux fondements pour la responsabilité climatique. Le concept d’écocide, dont l’inclusion dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est débattue, pourrait offrir une base pour sanctionner les atteintes graves et systématiques à l’environnement, y compris celles contribuant significativement au changement climatique.
Enfin, l’émergence des droits de la nature, reconnus dans plusieurs systèmes juridiques nationaux (Équateur, Bolivie, Nouvelle-Zélande), ouvre des perspectives novatrices. En reconnaissant aux écosystèmes une personnalité juridique propre, ces approches permettent d’envisager des recours au nom des entités naturelles elles-mêmes, dépassant ainsi les limites des approches anthropocentriques traditionnelles.
Ces innovations, encore émergentes, dessinent les contours d’un futur régime de responsabilité climatique plus complet et efficace. Leur développement nécessitera une mobilisation continue de la société civile, des juristes et des décideurs politiques pour transformer ces concepts prometteurs en mécanismes opérationnels de justice climatique.
